Outre des problèmes d’indépendance politique, l’Institut National de la Statistique ne publie aucune série longitudinale d’entreprises. Celles-ci sont pourtant indispensables pour éclairer les politiques publiques en faveur de l’emploi.
Produire des séries longitudinales d’entreprises consiste à suivre dans le temps les indicateurs de chaque entreprise de manière individuelle. Comme l’explique une étude de l’INSEE, il y a deux approches pour mener une analyse statistique : une approche longitudinale et une approche transversale. Quoiqu’une analyse transversale puisse être intéressante, elle n’en reste pas moins extrêmement partielle et peu explicative : elle est comme une photo ou une coupe d’une situation à un moment donné, sans raccordement à la situation antérieure.
Par exemple, si la France passe de 19 millions à 19,5 millions d’emplois marchands, une approche transversale consistera à détailler les variations nettes d’emplois pour chaque secteur: – 2% dans l’immobilier, – 5% dans la construction, etc. On compare un solde net d’emplois à un solde net d’emplois.
Une telle analyse occulte donc totalement le processus dynamique d’une économie, où des emplois se créent et se détruisent, même au sein d’un secteur. Or, s’il s’est créé un million d’emplois et qu’il s’en est détruit un demi million, ou s’il s’est créé 4 millions d’emplois et qu’il s’en est détruit 3,5 millions, le solde net reste identique mais l’intensité de la destruction créatrice n’est pas du tout la même.
Outre les variations brutes globales, il est par ailleurs nécessaire de comprendre quelles entreprises ont créé des emplois et lesquelles en ont détruit: dans chaque cas, sont-ce plutôt les petites entreprises ou plutôt les grandes ? Plutôt les jeunes entreprises ou plutôt les entreprises matures ?
Ainsi la notion de turbulence ou de rajeunissement du tissu économique est totalement absente des analyses de l’INSEE. Cette question est pourtant capitale. En effet si ce sont plutôt les entreprises nouvelles qui créent l’emploi, ou bien si ce sont plutôt les entreprises existantes qui créent l’emploi, la politique à mener n’est pas du tout la même. Dans le cas d’une entreprise nouvelle, le financement nécessaire viendra surtout des FFF (Family Friends and Fools[[Ou en français les CCC : Copains, Cousins, Cinglés.]]) ou des business angels, ce qui suppose des politiques en faveur de l’investissement par les personnes physiques. A l’inverse, dans le cas d’une entreprise existante, cela peut être aussi de l’autofinancement ou du crédit bancaire.
Dans tous les cas, l’évolution des principales données comptables devrait être suivie par l’INSEE année après année, afin de produire des données anonymisées accessibles à tout institut de recherche. Ce suivi n’est pas du tout impossible, voire même en partie réalisé. L’INSEE a en effet accès à de nombreuses bases de données, qui, après recoupements et retraitements éventuels permettent d’avoir les données individuelles année après année en termes d’effectif et de passif comptables.
Ces données se trouvent dans la base suse, « système unifié de statistiques d’entreprises », qui, comme son nom l’indique, regroupe et harmonise les différentes sources d’informations. Ce système utilise en premier lieu les données envoyées par la DGI (Direction Générale des Impôts) qui contiennent, par entreprise, les informations suivantes :
• les données saisies sur la déclaration fiscale : la plupart des montants comptables (compte de résultat, bilan, comptes annexes, etc.) ainsi que l’effectif salarié moyen, le numéro Siren, l’Activité principale exercée (APE), la durée et la date de clôture de l’exercice.
• des éléments d’identification : le nom, l’adresse, la forme juridique, l’identifiant Sirene et l’APE contenus dans le répertoire des impôts, etc.
A l’exception des micro-BIC[[Bénéfices Industriels et Commerciaux]] et micro-BNC[[Bénéfices Non Commerciaux.]], c’est-à-dire des entreprises individuelles qui ne font presque pas de chiffre d’affaires et n’ont donc quasiment jamais de salarié, ces premières données sont déjà relativement complètes. L’INSEE dispose par ailleurs de moyens de les recouper, les vérifier et les compléter, par confrontation avec l’enquête annuelle d’entreprises (EAE) réalisée par l’INSEE lui-même. Lorsque les sources fiscales et l’EAE ne suffisent pas à identifier ou corriger les comptes d’une entreprise, l’INSEE fait alors appel à des sources complémentaires d’information : SIRENE[[Sirene (Système Informatisé du répertoire National des Entreprises et des Établissements) est le répertoire administratif d’immatriculation des entreprises et il est géré par l’Insee. Il contient des informations topographiques, les dates de création et cessation et parfois des informations supplémentaires sur les évènements de la vie de l’entreprise.]], Diane[[Diane (Disque pour l’Analyse Économique) est une base de données comptables issues de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) qui centralise les comptes sociaux des entreprises déposés aux greffes de tribunaux de commerce. Ses données correspondent à la liasse comptable, les annexes (détail des comptes immobilisations, amortissements, provisions, etc.) étant plus ou moins renseignées. L’Insee n’accède qu’aux informations des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros.]], Citrus[[Citrus (Coordination des Informations et des Traitements sur les Restructurations d’Unités Statistiques) est une base de données sur les restructurations d’entreprises gérée par l’Insee. Elle est alimentée par des sources légales : Balo (Bulletin d’Annonces Légales Officielles), Bodacc (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) et par des sources statistiques : EAE, sources provenant du service de statistiques sur l’industrie (le Sessi : Service des Études et des Statistiques Industrielles), TVA, Enquête « Produits charges et actifs », données conjoncturelles (enquête « investissements »), Sirene, etc.]], ORT[[ORT est un service télématique de données comptables et d’annonces légales issues de l’Inpi. Il propose des données comptables correspondant à la liasse comptable et les informations du Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) qui font part d’évènements sur la vie des entreprises : absorption, cession, restructurations, etc.]], Infogreffe[[Infogreffe (Groupement de Greffes des Tribunaux de Commerce) est un service télématique de données comptables issues des Greffes des Tribunaux de Commerce. Ses données correspondent à la liasse comptable.]] et TVA[[TVA est une base de données sur le chiffre d’affaires des entreprises, produite par l’Insee et utilisée également pour bâtir un ensemble d’indices mensuels d’évolution des chiffres d’affaires. Elle est élaborée à partir d’une source administrative, le formulaire « CA3 », que doivent remplir les entreprises pour le paiement de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), tous les mois ou tous les trimestres.]]. Le schéma ci-dessous tiré du site INSEE récapitule le traitement des données :
Schéma général du fonctionnement de suse
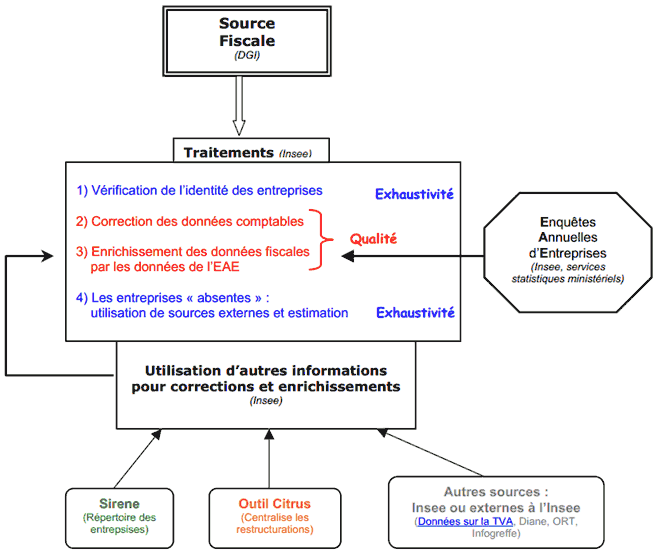
Le document de présentation du système suse – non daté – mentionne par ailleurs qu’un projet de refonte des statistiques structurelles d’entreprises est en cours. Il vise entre autres à donner un rôle accru aux déclarations annuelles de données sociales (DADS) qui fournissent des informations particulièrement précises sur les effectifs d’entreprises. Il semblerait que ce projet ait été mené à bien au moins pour partie puisque l’INSEE a produit des statistiques sur le nombre d’entreprises françaises à forte croissance[[Croissance en effectifs.]]. Ils ont été produits afin de répondre à une enquête Eurostat mais n’ont donné lieu à aucune publication sur le site de l’INSEE.
Ces statistiques semblent attester que l’INSEE a accès à des données URSAFF et qu’elle est capable de faire un suivi longitudinal des effectifs pour chaque entreprise. Si ces données existent effectivement, pourquoi ne sont-elles pas disponibles pour les organismes de recherche indépendants comme c’est le cas pour la Business Structure Database britannique ?

